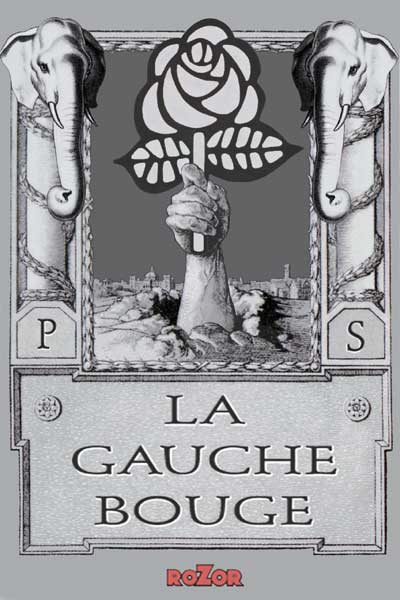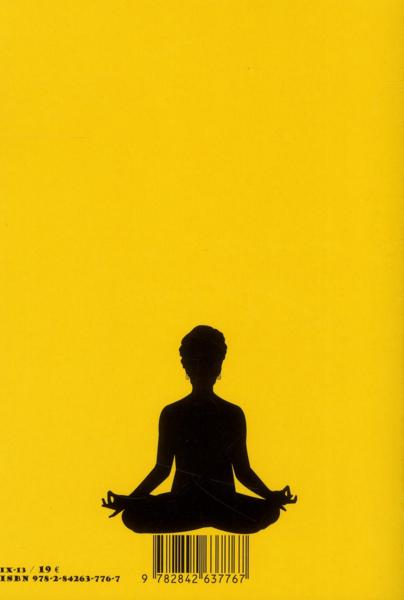Les manifs de droite(s) : du monde partout, personne nulle part
Le « Jour de colère » du 26 janvier à Paris a surpris et choqué : en brisant les lignes, en franchissant les opportunismes militants qui jusqu’alors avaient le mérite d’isoler les mouvements extrémistes, il a réuni en son sein des individus aux propos xénophobes, anti-mariage pour tous ou antisémites. On explique, comme Henri Vernet, que les propos tenus à l’encontre de la société dans son ensemble ont débordé des cadres du « réseau des réseaux », ceux d’Internet (Le Parisien 29/01). Youtube et Facebook n’ont pas le monopole de la parole publique : c’est toujours la rue qui gagne. Si les milliers de manifestants ont « surpris par la violence de leurs slogans », ils fragilisent aussi les contre-discours : la diversité dans leurs rangs allant des musulmanophobes et des musulmans, aux « Hommen » ou même au « camping pour tous ». Si Le Parisien relativise ainsi la force et la portée du mouvement, il n’en reste pas moins vrai que ces protestations de colère sont un signal d’alarme, annonciateur du « virage » à droite du gouvernement et, plus encore, de la radicalisation décomplexée de toutes les droites.
Les attaques en règle contre la volonté du gouvernement de briser les tabous du genre, le fantasme islamiste, la multiplication – brouillée – des boucs émissaires, l’implication d’enfants dans un microcosme de fureur désinhibé : la semaine suivant « le Jour de colère », Farida Belghoul, ancienne pionnière de « la Marche des Beurs », décrétait l’instauration des « Jours de retrait de l’école », visant à priver les enfants d’un droit, mais aussi d’un devoir inscrit dans le code de l’éducation. Et comme il ne fallait rien lâcher, c’est « la Manif pour Tous » qui a renchéri le 2 février, pour agiter l’épouvantail de la « familiophobie » du gouvernement. Cette seconde édition a donc remis le couvert, en dénonçant la « politique fiscale défavorable aux familles », la « réduction du congé parental », la peur d’un « retour de la PMA dans la loi famille », la reconnaissance de la gestation pour autrui (GPA), le « statut du beau-parent », ou encore l’instauration de « la prémajorité, qui restreint l’autorité parentale », comme l’explique Marine Turchi dans Mediapart (03/02). Le parallèle est de mise entre cette manifestation et « la Marche pour la vie » du 19 janvier, d’autant plus vigoureuse cette année face à la suppression de la notion de « détresse » par le gouvernement dans la loi sur l’IVG, et à côté de laquelle celle organisée en soutien aux femmes espagnoles et au droit à l’IVG a tristement fait pâle figure au sein des média.
Quand la rue passe l’arme à droite
En revanche, il faut ici distinguer l’opposition à la loi Taubira du 17 mai 2013, qui a convaincu le gouvernement d’ajourner le projet de loi sur la famille, de l’hétérogénéité, de l’incohérence des participants au « Jour de colère » du 26 janvier. Le 14 janvier (Slate.fr), Vincent Glad analysait l’appel fait au « Jour de colère » en comparant ses membres avec le phénomène des bonnets rouges, « en réunissant patrons, syndicalistes, agriculteurs et régionalistes, ont ouvert la voie à une nouvelle forme de mobilisation : […] faire reculer le gouvernement ». Selon Louis Dumont, l’un de ses organisateurs et interrogé par le site conservateur et libéral « Nouvelles de France », le 22 novembre 2013, le mouvement n’a ni leader, ni porte-parole, contrairement à « la Manif pour Tous ». Cette dernière qui aspire à imposer une certaine vision traditionnelle, patriarcale et sexiste de la société, nie et refuse d’accepter les mutations à la fois concrètes et cognitives des mœurs de ses concitoyens. Ironie du sort : les solidarités primaires, elles aussi, souffrent des excès de l’individualisme propre à notre époque. En revanche, « le Jour de Colère », lui, représente « des millions de Français qui ont été méprisés systématiquement par ce gouvernement ainsi que par la plupart des média à chaque fois qu’ils essayaient de faire entendre leurs voix », selon Louis Dumont. La « coagulation » est leur mot d’ordre. Bien triste issue pour une société déjà éclatée, qui n’a pas eu ses indignés, contrairement à l’Espagne ou à la Grèce : Jean Birnbaum, dans Le Monde (01/02), remarquait ainsi que la colère ne faisait pas une politique, qu’elle est l’indignation amputée de son espérance. Le constat d’un peuple français uni autour d’un sentiment si peu constructif est fait. Personne ne nous volera notre Révolution, si elle est tuée dans l’œuf par ces « jours de colère » aveugles à tout espoir, à toute vision de progrès pour la société.
Le 6 février dernier, certains ont rappelé le triste anniversaire des mobilisations anti-gouvernementales formées de groupuscules d’extrême droite et d’inspiration fasciste en 1934. Patrick Le Hyarick souligne dans son blog (06/02) que « Paris n’avait pas brui de slogans antisémites aussi violents tels : « dehors les juifs », depuis l’occupation nazie ». Le Huffington Post (27/01) décrit, sous la plume de Geoffroy Clavel, comment Yvan Benedetti, chef de file du groupuscule pétainiste, aujourd’hui dissous, « L’Œuvre française », avait « fièrement défilé en scandant “Travail, famille, patrie” avant de tenter de s’approprier le micro en fin de cortège ». L’article, qui cite le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), souligne ainsi comment cette manifestation « agrégeait dans la même haine antirépublicaine, les chrétiens intégristes homophobes et les nationalistes racistes musulmanophobes ».
« La peur ne fait pas une politique »
Dans Le Monde (05/02), Jean-Baptiste de Montvalon revient sur certains moments politiques de l’Histoire où les gouvernements se sont risqués au changement, parfois même au progrès social, au risque de s’attirer les ires d’une société qui n’y était pas préparée, voire totalement opposée. Car si la politique est bien une affaire de vision d’un certain idéal commun, elle est aussi le fait de choix, de convictions individuelles voire égoïstes qui font que Machiavel est toujours d’actualité. L’abolition de la peine de mort, dont certains réclament encore aujourd’hui le rétablissement, reste pour de nombreux analystes le symbole à part entière d’un acte politique détaché de l’opinion publique et des ambitions électoralistes. Il faut ici souligner que les revendications formulées clairement par les organisateurs des manifestations extrêmistes ont permis le recul du gouvernement, humiliant la ministre chargée de la famille et démontrant aux électeurs de gauche déçus, qu’à défaut de les écouter, ce pouvoir défait ses propres lois. À l’inverse, comme le répète Serge Halimi dans Libération (05/02), « La peur n’est pas une politique ». De même que la colère.
Dominique Reynié, dans Le Figaro (07/02), souligne, au-delà du mutisme socialiste caractéristique des blocages internes au parti, que si « La France a des institutions démocratiques […] elle manque de culture démocratique ». L’empressement affiché de Manuel Valls à criminaliser, à dénigrer chaque manifestation ou mouvement social avant même qu’il ne se produise (rappelons-nous déjà comment le ministre de l’Intérieur s’était rangé aux côtés des forces de police avant l’organisation de manifestations pro-Dieudonné), fait ainsi de la liberté d’expression – populaire, qui plus est – un marqueur de transgression qui ne doit pas nous laisser indifférents. Sur France 2, dans l’émission « Mots Croisés », Pierre Moscovici lançait à Marine Le Pen : « Vous n’avez pas le monopole du peuple ». Une bien pauvre défense quand on voit à quel point la gauche est en train de le perdre, quand elle finit par se coucher devant l’autel du conservatisme, en enterrant de fait le projet de loi sur la PMA. Jack Dion, dans un article de Marianne (07/02), affirme que « comme Tony Blair ou Gerhard Schröder avant lui, François Hollande est rentré au bercail de la bien-pensance, fermant une boucle ouverte par François Mitterrand dès 1983, avec le tournant de la rigueur. Le candidat Hollande avait pourtant l’avantage d’un diagnostic simple et partagé par la majorité de ses électeurs : « l’ennemi, c’est la finance ». Mais lorsque la crise sociale ne vient pas, comme le précise Dion, de l’inaboutissement de « promesses irresponsables formulées en période électorale et impossibles à appliquer », mais bien « d’un diagnostic juste non suivi d’effets concrets ou de décisions adaptées », on assiste alors au paroxysme d’une politique contre-productive faisant le lit de son propre discrédit. Face aux manifestations « de droite », ce sont les membres de l’UMP comme du PS qui sont mis en difficulté. Les premiers veulent éviter deux écueils, comme l’écrit Isabelle Ficek dans Les Échos (06/02) : l’ignorance (donc l’abandon d’un électorat potentiel) et la récupération maladroite, pouvant mener à la surenchère, illustration tannée d’une stratégie politique désormais commune aux deux partis majoritaires, désarmés face à la montée du FN.
Le peuple de gauche, lui aussi, a le droit (et le devoir) de s’exprimer et de faire bouger les lignes. À ceux qui abandonnent l’indignation pour la colère ou pire, la résignation, il est temps de prendre conscience que ces manifestations sont à la fois liberticides et dangereuses pour notre avenir à tous. Les plus réfractaires au progrès social, qui semblent être les seuls à recevoir un écho de la part du gouvernement, en viennent à menacer nos droits les plus élémentaires et les plus fondamentaux comme le droit à l’avortement, à l’abolition de la peine de mort ou à s’unir librement. Le droit de vote des femmes lui-même, véritable pierre angulaire de notre passage à la démocratie (selon Cohn-Bendit) ne fut que tardivement adopté à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. N’oublions pas Clément Méric, les femmes espagnoles, ne laissons pas les luttes du passé, et leurs succès, aux mains des conservatismes fondamentalistes et patriarcaux qui menacent nos acquis sociaux.