Des cadavres dans le placard.
Quand déménager fait « pschyyyyt » : Les confessions d’Alice
Quand déménager fait « pschyyyyt » : Les confessions d’Alice
La scène d’ouverture est calme, trop calme. La jeune Lili, juchée sur son vélo, traverse un pont vide où gît une voiture abandonnée, portière ouverte. Personne à l’horizon. Plus loin, ce sont les rues qui sont désertes, comme si malgré le jour et la lumière éclatante qui éclaboussent la chaussée, c’était la fin du monde pure et simple qui s’y était implacablement installée. Le silence règne quand soudain, surgissent aux trousses de l’enfant une meute de chiens enragés, galopant à en perdre haleine vers une destination que l’on ignore. Le spectateur entre alors dans « White God » avec un avant-goût d’apocalypse inexpliquée : les chiens fuient-ils ou poursuivent-ils la fillette ? Ont-ils un but ? Pourquoi continue-t-elle à pédaler, droit devant elle ? La séquence s’interrompt brutalement, et laisse en suspens l’issue de la scène, un plan large où la meute semble engloutir le vélo avant de disparaître derrière un mur, au ralenti.
Nous sommes à Budapest, en Hongrie. Pour favoriser la reproduction des chiens de race, le gouvernement impose une taxe sur les bâtards à tous les foyers. La jeune Lili et son chien Hagen se retrouvent alors entraînés dans un cauchemar sans fin où, séparés, ils doivent subir une loi implacable et arbitraire. La taxe devient ici une arme de dissuasion et de contrôle : vidée de son rôle de redistribution et de justice sociale, elle n’est plus qu’un châtiment cruel et sadique, dont l’oppression vicieuse dépasse de loin la pure et simple interdiction. Kornél Mundruczó utilise ici la parabole canine pour illustrer avec un réalisme troublant la société hongroise, où le gouvernement libéral et nationaliste de Viktor Orbán cohabite dans les sondages avec le parti d’extrême-droite Jobbik.
Wild dogs
Jeté à la rue par le père de Lili, qui craint la nouvelle taxe, Hagen quitte le cocon domestique et tente de survivre à l’état sauvage, avant de rejoindre un groupe de chiens errants. L’instabilité et les sursauts permanents de la caméra illustrent ici le sentiment d’urgence et de fébrilité qui anime Hagen, égaré mais traqué. La jeune Lili, elle, garde tout au long du film ce visage grave et mature, incrustant au milieu d’un casting presque uniquement masculin l’empreinte d’une force féminine de résistance sans âge, sans illusion. Les seules marques de douceur qu’elle manifeste sont l’affection qui la lie à son chien et à sa musique. Comme un triangle fragile, Lili aime Hagen, puis joue de la trompette. Hagen écoute et s’endort en aimant Lili. Cet équilibre, qui pour certains frôlera la mollesse voire l’idéalisme mielleux, révèle pourtant l’issue du film. Cette vingtaine de minutes, où le réalisateur nous plonge dans l’insurrection de plus de deux cent chiens « échaudés » par leur séjour en fourrière, monte crescendo pour exploser en attaques sanglantes voire carrément gores des anciens maîtres de la cité. Le plan final lui, semble être le constat froid que la servitude volontaire reste l’indépassable condition du système.
On connaît déjà toute la cruauté que les hommes savent infliger aux animaux, et surtout à ceux qu’ils prétendent domestiquer. Et celle qu’a voulu nous montrer Kornél Mundruczó, la pire peut-être, est ce transfert, cet apprentissage brutal du désir de tuer et d’éliminer. C’est l’invention de cette haine qu’infligent à Hagen les hommes du film, des courses-poursuites épuisantes pour échapper à la fourrière aux combats de chiens organisés sous les toits de tôle, la mort en jeu. Lorsqu’il est vendu par le propriétaire d’un restaurant à un dresseur particulièrement véreux et organisé, Hagen entre dans ce cercle vicieux. Celui où le dominant orchestre, par les coups et les drogues, le glissement rampant de l’esprit simple et confiant du dominé vers la soif sanglante de détruire. La mise en scène de la violence humaine, qui rappelle à certains égards celle du film « Amours chiennes », d’Alejandro González, tient tant dans l’oppression chronique des lois naturelles que politiques. Les hommes, en plus d’avoir le pouvoir de cette « violence légitime » sur l’animal, peuvent aussi légiférer et choisir de laisser vivre ou de faire mourir. Un constat cynique et cinglant des dérives de l’autoritarisme et de la manipulation des masses, qui résistent ou renaissent encore aujourd’hui en Europe.
WHITE GOD, de Kornél Mundruczó
Avec Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth
Hongrie, 2014, 1h59

Dans un roman vif et acéré, Gauz nous plonge dans l’histoire et le quotidien de ces immigrés africains reconvertis en vigiles des magasins parisiens. Un récit rapide, mais efficace, qui n’épargne personne, où l’auteur raconte un Paris d’hier et d’aujourd’hui, avec ses lieux communs, ses magasins, ses pièges et ses immigrés.
L’histoire commence comme celle de beaucoup d’entre nous : dans une queue, attendre pour un emploi, remplir et montrer des papiers, trouver une place, au milieu de tous les autres. Cette place, c’est celle du vigile, « debout-payé ». Un job facile, un sésame pour beaucoup d’immigrés africains, ces funambules aux multiples styles, langues ou histoires. Comme l’écrit l’auteur Gauz, Armand Patrick Gbaka Brédé de son vrai nom, Ivoirien d’origine, « Quand on sort du chômage, on manque d’assurance ». Une ironie qui lance le ton du livre, sans condescendance. Né à Abidjan et arrivé en France à 28 ans, l’auteur a connu « les arcanes de l’administration », celle qui rend fous les Français de souche et se fout royalement de ceux d’en dessous, les sans-papiers. Gauz a écumé tous les petits boulots : scénariste, baby-sitter, jardinier, réalisateur, hotliner, vigile. Il raconte et se raconte aussi dans ce roman, qui plonge le lecteur dans la peau de ces hommes omniprésents, mais invisibles, les agents de sécurité.
De Camaïeu à Séphora, Gauz décrit ces jungles familières et climatisées, bondées de monde où règnent l’opulence et les fastes de l’hyperconsommation. Ces lieux que nous croyons connaître, voire même parfois exécrer sans les comprendre. L’auteur, à travers ses lunettes de vigile, scinde, tranche et sonde avec pertinence nos propres comportements. Et tout le monde y passe, comme au scanner : les filles, grosses ou maigres, les voleurs, les Africaines et les Chinoises, leurs fesses et leurs maris, les bébés, les prix, les vieux, les cheveux ou les handicapés. En somme, dans un décor en carton-pâte qui clignote et où « Tout est en soldes, y compris l’amour-propre », il éclaire aussi ce qui anime encore notre société, bricolée de toutes ces petites fausses notes.
« Quand on ne comprend pas l’autre, on l’invente »
Des flashs lucides, mais qui ne prétendent pas à la science encyclopédique : comme il est remarqué dans le livre « Quand on ne comprend pas l’autre, on l’invente, souvent avec des clichés ». Ces petites chroniques des grands magasins laissent aussi place à l’imagination de l’auteur, comme lorsqu’il imagine des « nommeurs », dont le métier consiste à inventer autour d’une table les noms (souvent absurdes) des vêtements des pièces de prêt-à-porter. Le lecteur est entraîné dans un équilibre précaire entre notre époque, celle d’avant, des autres et leurs propres rêves.
Le livre manque certes de profondeur, mais pas de matière. Les épisodes autobiographiques, qui mêlent histoire et politique, mériteraient un ouvrage à eux seuls. On y suit alors l’arrivée et les galères de ces étudiants congolais, sénégalais ou ivoiriens à Paris, et répartis dans des résidences par nationalité. De bronze, d’or où de plomb, ces âges de l’immigration sont aussi ceux de la société française : la décolonisation, les crises économiques, le tournant psychotique du 11-Septembre. Mais c’est bien là le charme de ce récit : celui, maladroit, d’un balancement entre deux mondes, trois générations, plusieurs quotidiens. Gauz ne résiste pas non plus à ces fulgurances rancunières – « La République se branle » – envers une France toujours plus sécuritaire, toujours plus sectaire aussi. Et c’est une juste mise en abîme qui nous y amène, celle de ces vigiles noirs, habillés en noir, qui surveillent d’un œil leurs clients tout en surveillant de l’autre le véritable Big Brother : les lois, l’administration, la régularisation. Car dans un monde où chacun veut voir et être vu, l’auteur rend aussi un hommage à la fois lucide et rare sur ces communautés silencieuses, dans l’angle mort de la vigie républicaine, mais bien trop souvent sous les feux de ce triste constat : « On ne gère que le sentiment d’insécurité ».
Debout-Payé, de Gauz
Le Nouvel Attila, août 2014
192 pages, 17 euros
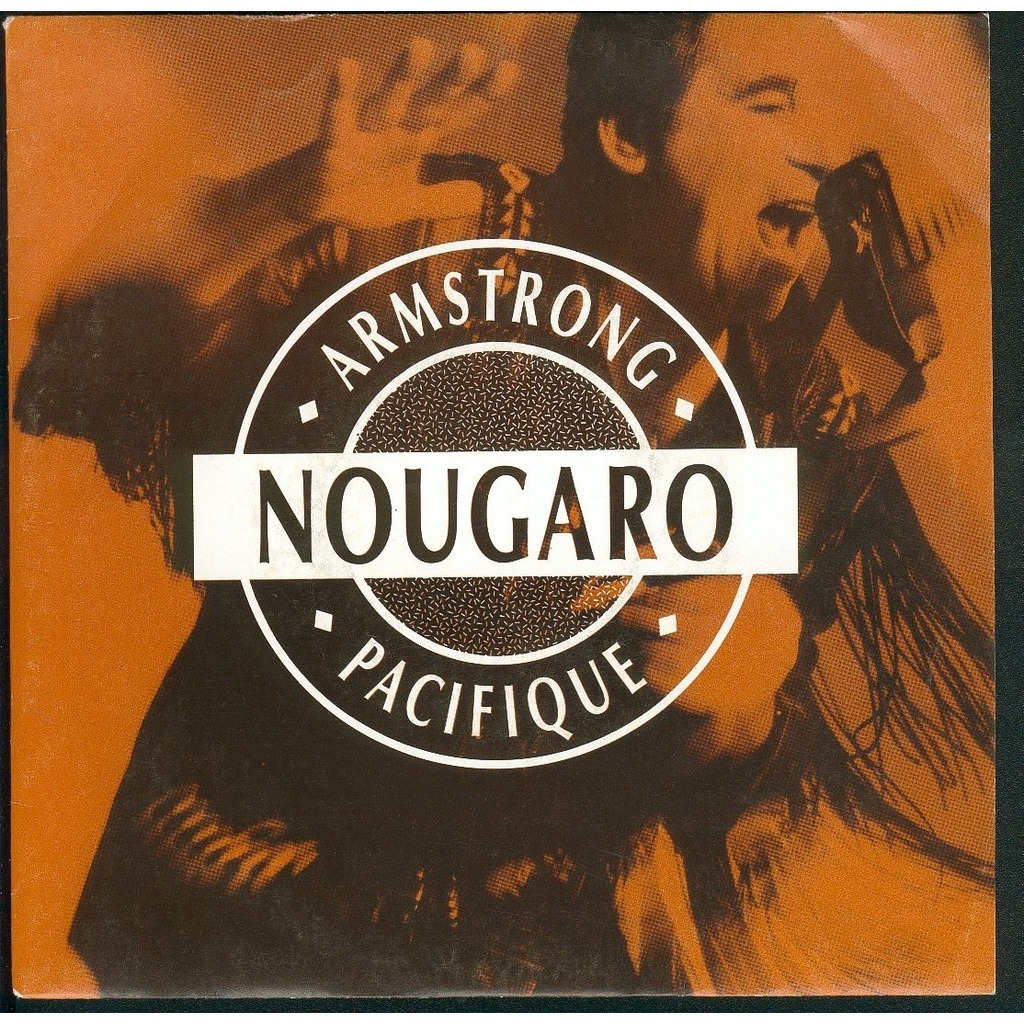 Le 18 novembre, la conseillère municipale UMP de Combs-la-Ville, Claudine Declerck, a démissionné après avoir partagé sur son compte Facebook une caricature de Christiane Taubira intitulée « Y’a pas bon Taubira », en référence à la célèbre publicité néocolonialiste (Le Monde, 18/11/2013).
Le 18 novembre, la conseillère municipale UMP de Combs-la-Ville, Claudine Declerck, a démissionné après avoir partagé sur son compte Facebook une caricature de Christiane Taubira intitulée « Y’a pas bon Taubira », en référence à la célèbre publicité néocolonialiste (Le Monde, 18/11/2013).Cet épisode est à l’image des comportements racistes auxquels la société française est confrontée depuis plus d’un mois déjà. Christine Taubira, garde des Sceaux, en est le symbole : elle a fait les frais d’agressions verbales dégradantes et offensantes. Les langues se délient et certains n’ont désormais plus honte de s’attaquer à une ministre, de la Justice, qui plus est.
Le 17 octobre déjà, Anne-Sophie Leclere, alors candidate du Front national à Rethel (Ardennes) pour les municipales de 2014, intervient dans l’émission Envoyé Spécial consacrée aux « nouveaux visages » du FN. Interrogée sur un photomontage publié sur sa page Facebook y représentant Christiane Taubira à côté d’une photo d’un jeune singe, la militante s’est justifiée en assurant que cette image n’était pas raciste. Selon la candidate FN, « ça n’a rien à voir, un singe reste un animal. Un Noir, c’est un être humain ». (Jdd, 18/10/2013). À croire qu’en plus d’une subtilité douteuse dans la métaphore filée par Leclere, celle-ci cherche à se défendre d’une logique tout aussi hasardeuse. Le couperet tombe dès le lendemain avec sa suspension. Florian Philippot, vice-président du FN, évoque une « erreur de casting ».
On sait les citoyens touchés par le scepticisme à l’égard du gouvernement en place. En témoigne la manifestation organisée par l’association « catholique intégriste » Civitas, le 20 octobre à Paris, en réaction aux propos de Pierre Bergé ayant affirmé sur RTL son désir de voir supprimer toutes les fêtes chrétiennes du calendrier. Criant à la « cathophobie », la manifestation s’est rapidement transformée en un véritable cirque du « tous pourris » en s’échauffant sur les francs-maçons avant de s’attaquer à Christine Taubira, du fait de son rôle dans l’instauration de la loi sur le mariage pour tous, via la voix de l’Abbé Xavier Beauvais qui entonne un tonitruant « Y’a bon Banania, y’a pas bon Taubira ». Les images de cette injure seront reprises par le Petit Journal dans une séquence vidéo intitulée « La manif qui sent bon la pastille Vichy ». Tout est dit.
Cinq jours plus tard, la contamination est avérée. En déplacement à Angers, la ministre se fera insulter devant le palais de justice, cette fois-ci par des enfants. Pensant par ce geste ignoble suivre les sages idées de ses parents, une fillette brandit la « banane de la discorde » en traitant Christiane Taubira de « guenon », ce qui lui vaudra un billet aussi cinglant que poétique de la part du chroniqueur de France Inter, François Morel. L’incident fait l’objet d’une question à l’Assemblée, le malaise est présent, mais on hésite encore à donner trop d’importance au sujet. Risque de médiatisation excessive du racisme ? Pourtant, les consciences s’éveillent et les contre-discours s’affirment comme dans le cas de Harry Roselmack qui s’interroge, dans une tribune, sur le retour du racisme en France.
Il faut attendre la Une de l’hebdomadaire Minute du 13 novembre – sur laquelle on peut lire « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane » – pour que naisse un soutien quasi unanime. Pendant que Jean-Marc Ayrault saisit le procureur de la République de Paris, Manuel Valls, annonce que le gouvernement étudie « les moyens d’agir contre la diffusion du journal ». Du côté des intellectuels, l’écrivain Marie Darrieussecq a dédié son prix Médicis à la ministre de la Justice alors que plusieurs personnalités – dont l’historien Benjamin Stora et l’actrice Jeanne Moreau – ont cosigné une tribune intitulée « Nous sommes tous des singes français » afin de dénoncer l’ « infâme » Minute.
Enfin, si Marine Le Pen a qualifié d’un « archi-nul » la Une de Minute, elle n’a pu s’empêcher d’attaquer Christiane Taubira sur le fait qu’elle serait « anti-française », point sur lequel le père de la présidente du FN semble (enfin) s’accorder. Face à l’hypocrisie d’une extrême droite qui prétend « mépriser » le racisme tout en continuant de jouer les néocolonialistes en fustigeant le passé indépendantiste de Christiane Taubira, laissons à la principale intéressée le soin de conclure. Lors de la journée du 16 novembre que la scène du TARMAC a consacrée à Frantz Fanon, la ministre de la Justice a clamé – 52 ans après la parution des Damnés de la Terre – que le racisme « a forcément recours au bestiaire, il évoque la réputation du jaune, les hordes, les grouillements. […] Ces gens-là, décidément, n’ont pas d’imagination. Voilà pourquoi ils sont déjà vaincus. Mais nous devons non seulement les vaincre, mais le leur faire savoir. Il faut qu’ils sachent qu’ils sont vaincus, du passé, déjà finis, dévitalisés, desséchés ». Lors d’un rassemblement contre les extrémismes organisé par le PS à la Mutualité le 27 novembre, Manuel Valls a affirmé que Christiane Taubira et lui-même formaient un « beau couple ».
Face aux attaques portées contre la République, le ministre de l’Intérieur a réaffirmé la « force de l’état de droit » qu’il incarne auprès de la ministre de la Justice. Lors de ce meeting, la garde des Sceaux a été ovationnée et a répondu à ceux qui l’avaient attaquée : « Ils commencent par vilipender les apparences, ils commencent ainsi par la différence qu’ils voient et ils finissent par celle qu’ils imaginent. Et ils mettent tout le monde et chacun en danger.» Et après avoir prononcé un plaidoyer poignant pour la défense de la République et de son école, Christiane Taubira a clamé derechef qu’elle continuera de « barrer la route » aux « racistes, antisémites et xénophobes ».
Après cette mobilisation politique, ce fut au tour du monde de la culture d’organiser une soirée contre le racisme au théâtre du Rond-point, le 2 décembre dernier. Là encore, une poignée de militants d’extrême droite attendait Christiane Taubira dans le seul but de la conspuer. En dépit de quelques sifflets, la ministre a rappelé que sa personne comptait peu et que son « inquiétude profonde » était pour ces millions de personnes que compte le pays et qui sont de nouveau affectées par ces violences. A l’intérieur du théâtre, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, est présente auprès de Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste, ainsi que de Valérie Trierweiler. A leurs côtés, des acteurs, musiciens et humoristes sont là pour soutenir la ministre de la Justice. L’humoriste Guy Bedos y a résumé la tâche difficile du combat contre le racisme avec un bagou et une crudité verbale qu’on lui connaît bien : « Il faudrait un traitement médical contre la connerie ! Parce que le racisme, c’est de la connerie ! ».
Contre le racisme et pour l’égalité des droits
(déclaration de Fabienne Haloui, membre du comité exécutif national du PCF, responsable du secteur droits et libertés.)
C’était il y a 30 ans, jour pour jour. Le 3 décembre 1983, près de 100 000 manifestants défilaient de la place de la Bastille jusqu’à Montparnasse, 1 mois ½ plus tôt une trentaine d’enfants d’immigrés et de militants anti racistes étaient partis de Marseille en décidant de marcher dans la voie de Martin Luther King. Victimes de violences racistes, maintenus dans l’invisibilité, ces jeunes, fils et filles nés sur le sol français de parents immigrés, ont choisi alors une action pacifique pour demander ce que la République leur refusait : l’égalité. Aujourd’hui, force est de constater que le combat est loin d’être gagné. Les attaques abjectes contre Christiane Taubira et le racisme ordinaire subi par des millions de Français anonymes nous démontrent qu’il ne faut jamais baisser la garde.
Trente ans après, sur fond de crise économique, malgré certaines avancées, un constat s’impose : notre société n’a pas traité ses enfants à égalité. A situation sociale égale, les enfants et petits enfants d’immigrés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne sont plus discriminés. La couleur de leur peau et leur patronyme en font des éternels immigrés ! Français à 97 % ils se sentent toujours perçus comme des «issus de », et à 67 %, ils pensent que « le regard des autres ne fait pas d’eux des Français ». Rien d’étonnant puisqu’un Français sur trois conteste leur appartenance à la nation.
Au nom d’une France mythique, mais irréelle, les théoriciens du choc des civilisations identifient la menace, une immigration de masse et un nouvel ennemi de l’intérieur, le musulman. Ils déplacent ainsi la question sociale sur le terrain identitaire favorisant le développement d’un racisme culturel, largement banalisé par la mandature Sarkozy, un racisme décomplexé et assumé comme en attestent les propos tenus sur les Roms ou les musulmans.
La lutte contre le racisme passe par la conquête de droits pour rétablir l’égalité entre toutes et tous. Le gouvernement doit donner l’exemple en déclarant la lutte contre le racisme et les discriminations, grande cause nationale, en produisant des actes concrets pour l’égalité parmi lesquelles : le droit de vote des résidents étrangers, la mise en place d’un récépissé contre les contrôles au faciès, la régularisation des sans-papiers. La réalisation d’un travail de mémoire et d’histoire critique sur la colonisation et les migrations est aussi indispensable : vieux pays d’immigration, pluriel, métissé, multiconfessionnel la France ne se représente pas et ne s’assume pas comme tel. Ouvrons ce débat ! La France est la France lorsqu’elle fait vivre ses valeurs de liberté d’égalité et de fraternité n’en déplaise à Jacques Bompart, maire d’Orange qui considère que les inégalités sont naturelles et qu’il faut donc les respecter. La France n’est pas celle des nostalgiques de l’ordre colonial n’en déplaise à Jacques Bompart qui s’apprête à baptiser une avenue du nom d’un partisan de l’Algérie française. C’est avec la France telle qu’elle est dans sa diversité que nous devons inventer la société du vivre ensemble, solidaire, laïque, fondée sur l’égalité des droits pour tous, le refus des discriminations, le respect de l’altérité culturelle, la citoyenneté de résidence, la valorisation de la culture du métissage.

L’arrestation de Jang Song Thaek – l’oncle par alliance de Kim Jong Un et numéro 2 officieux du régime – en pleine réunion du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée (PTC) dimanche 8 décembre, avait déjà soulevé de nombreuses interrogations. Après avoir été jugé par un tribunal militaire spécial, le vice-président de la Commission de défense nationale aurait été exécuté « à la mitraillette », jeudi 12 décembre, pour avoir commis des « actes criminels » et dirigé une « faction contre-révolutionnaire », selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.
Faut-il y voir une réponse à un acte de « trahison » d’un oncle présenté comme étant « le garant de l’adhésion de l’armée derrière le nouveau leader » et l’« l’homme de Pékin » ou la volonté d’affirmer l’absolutisme du pouvoir de Kim Jong Un en éliminant l’influence d’un oncle qui lui aurait fait trop d’ombre ?
S’il est encore un peu tôt pour le savoir, il est en revanche possible d’observer, à travers l’exécution de Jang Song Thaek, l’éviction d’un des derniers hommes de la vieille garde et une vigoureuse reprise en main de l’armée et de l’appareil du PTC.
Si « la puissance politique se développe hors du baril d’une arme à feu », on oublie souvent de rappeler l’intégralité de la citation de Mao Zedong qui finit par cette injonction : « Et le Parti doit commander aux fusils ».
Anthony Maranghi